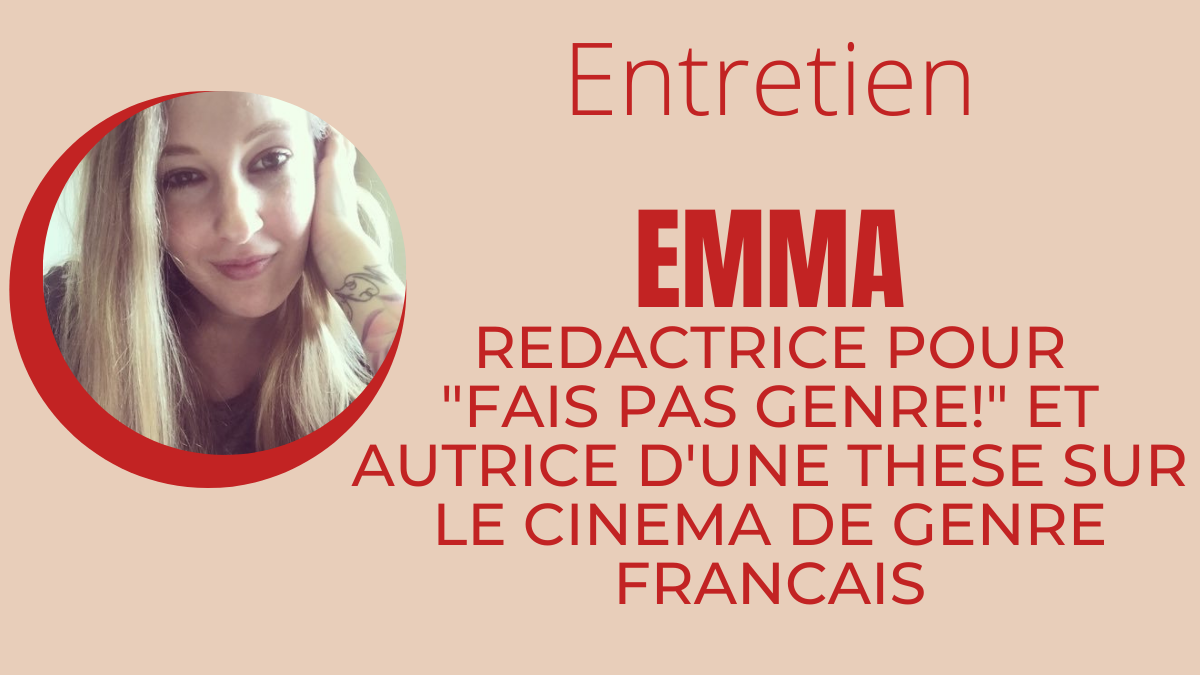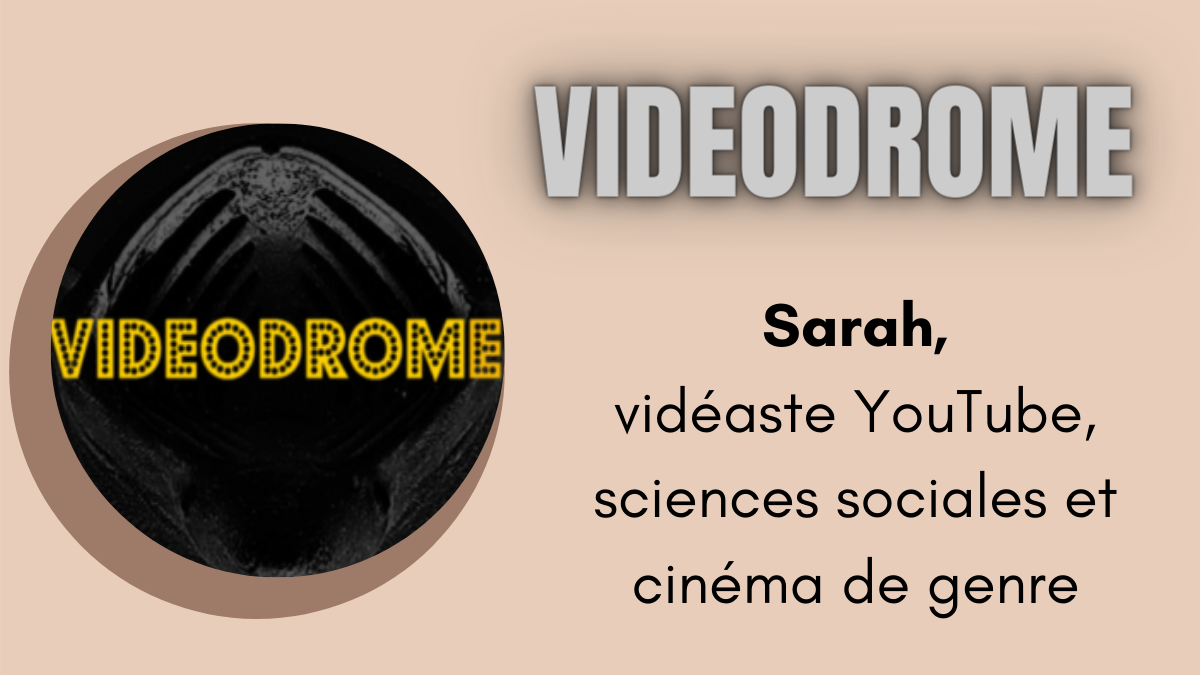Créatrice de contenus est un terme qui correspond à Flo tant elle diffuse sa passion du cinéma asiatique via plusieurs canaux: site web (Wongkarwaifu), podcast, newsletter…en montrant sa diversité et ses portées politiques.
On a parlé de politique & création de contenu, films féministes et cancel culture (non).

Peux-tu te présenter ?
Je m’appelle Flo et j’écris sur Internet sous le pseudonyme de WongKarWaifu, un genre de mot-valise entre Wong Kar-wai et Waifu.
Je donne essentiellement mon avis sur le cinéma d’Asie de l’Est. C’est quelque chose que j’ai commencé à faire sur mon temps libre en 2022, tout d’abord sur Twitter, puis sur mon site sous la forme de textes beaucoup plus longs. Aujourd’hui j’utilise essentiellement Bluesky pour discuter avec mes camarades cinéphiles. Mon site me permet de publier des articles de fond, et ma newsletter chronique l’actualité du cinéma d’Asie chaque semaine.
Je pense que j’ai commencé à écrire pour passer le temps, m’occuper l’esprit et partager cette passion avec des gens, plutôt que de la vivre seule chez moi ou dans une salle de cinéma, ahahah.
Tu utilises plusieurs formats pour partager ta passion du cinéma asiatique (réseaux sociaux, newsletter, article, podcast). Comment abordes-tu ton contenu selon les formats? Qu’est ce que la diversité de format apporte selon toi?
C’est une question à laquelle je réfléchis régulièrement ! Je crois que chaque plateforme et chaque format me permet d’aborder le sujet d’une manière différente. J’aime bien l’exercice de concision et de synthèse que requiert Bluesky. Ça me permet aussi de poster des bêtises ou de parler d’autre chose, même si j’essaie de ne pas trop le faire comme je suppose que les gens s’abonnent essentiellement pour mon avis sur le cinéma. Parfois, j’ai l’impression d’avoir trop à dire pour ce genre de plateforme, alors j’utilise Letterboxd pour articuler ma pensée. Je ferais une bien piètre critique de cinéma mais j’aime bien coucher mes réflexions à l’écrit.
Ensuite, mon site me permet de creuser des sujets en profondeur de temps en temps. J’aime bien mettre en lumière des artistes qu’on oublie trop souvent quand on parle de cinéma. C’est pour ça que j’ai consacré des articles à des costumières, un monteur son, une décoratrice, etc. C’est vraiment de la transmission de savoir et j’ai l’impression que c’est ce que je fais de plus utile même si ça prend beaucoup de temps et d’énergie. C’est aussi ce que j’essaie de faire dans une moindre mesure quand je suis invitée dans une émission : j’essaie d’utiliser cet espace de parole pour contextualiser les films et faire de la pédagogie. Je crois que je préfère procéder ainsi, plutôt que de simplement donner mon avis sur les films, comme je n’ai pas spécialement de légitimité ou d’autorité dans le domaine.
J’ai aussi créé un serveur Discord pour papoter avec les gens, regarder des films ensemble, partager des informations, ce genre de choses. Je suis très attachée au côté communautaire et encore une fois ça permet de vivre sa passion avec d’autres personnes. C’est un espace où chacun·e peut s’exprimer.
Enfin, la newsletter a un côté très utilitaire. Je pense que les réseaux sociaux et les moteurs de recherche ne sont plus des outils assez fiables pour suivre l’actualité ou trouver des informations. Beaucoup de gens peinent à faire le tri dans le déluge d’informations qui arrivent chaque minute dans leur fil d’actualité. C’est là que j’interviens, ahah ! Je fais pas mal de curation, et comme c’est hebdomadaire et que ça arrive directement dans la boîte mail de la personne, ça donne un côté magazine que je trouve assez chouette. J’aime à penser que c’est devenu un rendez-vous pour quelques personnes.
Si j’avais les compétences et les moyens techniques nécessaires ainsi que beaucoup plus de temps libre, j’aimerais bien animer des émissions en direct, m’entretenir avec des artistes ou créer du contenu vidéo mais je pense que pour le moment je vais me limiter à l’écrit, ahah.
J’ai l’impression que l’immense majorité des créateur·ices de contenu ont peur de se positionner sur les réseaux sociaux. J’ai cependant l’impression que s’en tenir à une ligne claire et sans concession permet au contraire d’obtenir la confiance des gens.
Quels sont les plus gros clichés sur le cinéma asiatique selon les pays d’après toi?
Vaste question ! Je suppose que ça dépend de qui véhicule les clichés en question.
Pour le grand public, j’imagine que ça se résume aux films d’arts martiaux hongkongais et à l’animation du studio Ghibli.
Côté cinéphiles, j’ai l’impression que pas mal de gens ont des idées reçues sur les industries de chaque pays : “le cinéma hongkongais est mort”, “le cinéma chinois est propagandiste”, “le cinéma taïwanais est contemplatif”, ce genre de choses.
De façon générale, je crois surtout qu’il y a une méconnaissance du sujet, surtout en ce qui concerne les pays d’Asie centrale ou d’Asie du Sud-Est. Parmi les gens qui aiment le cinéma japonais, assez peu vont avoir la curiosité de s’intéresser aux films mongols ou vietnamiens. C’est dommage de résumer un continent entier à cinq pays.

Tu assumes sans détour tes positions politiques, que ça soit sur l’actualité ou le cinéma. En quoi est ce important pour toi? Est-ce que ça te vaut du cyberharcèlement?
C’est quelque chose que je fais au quotidien avec mes ami·es, alors je me voyais mal m’autocensurer sur Internet, a fortiori à une époque où on laisse de plus en plus de place aux discours réactionnaires.
Je pense que c’est une attitude plutôt saine. Je ne cherche pas systématiquement le conflit mais je ne crois pas non plus que ce soit quelque chose dont on devrait avoir peur. Si les célébrités et les médias adoptaient tous·tes un positionnement politique clair, ça permettrait à chacun·e de renforcer son esprit critique et de soutenir les gens en connaissance de cause.
J’ai l’impression que l’immense majorité des créateur·ices de contenu ont peur de se positionner sur les réseaux sociaux. C’est sans doute pour se prémunir du harcèlement des communautés d’extrême droite, ou pour éviter d’aliéner une partie de leurs abonné·es. J’ai cependant l’impression que s’en tenir à une ligne claire et sans concession permet au contraire d’obtenir la confiance des gens.
Quand j’étais encore sur Twitter, ça m’a valu pas mal d’insultes et quelques menaces de mort, mais je ne crois pas que ça me soit arrivée depuis que je suis sur Bluesky. Comme quoi, c’est aussi une histoire de modération et de choix de l’espace dans lequel on s’exprime.
Dans ton article « I Am What I Am : perspectives aro-ace », tu évoques le paradoxe entre le conservatisme japonais à l’égard des LGBTQIA+ et le fait que tant qu’il est dans la fiction et qu’il peut servir de vitrine à l’international pour que le Japon soit perçu comme progressiste, c’est toléré. Quel est le regard et la réaction de la communauté LGBTQIA+ japonaise là-dessus? Et des cinéastes?
Je ne sais pas du tout comment se positionnent les personnes LGBTQIA+ du Japon sur la question.
Côté cinéastes, j’ai le sentiment que ce genre d’œuvres est avant tout quelque chose de personnel. Évidemment, certain·es cinéastes vont évoquer des sujets comme l’homosexualité sans être directement concerné·es mais une bonne partie de ces films sont produits, écrits ou réalisés par des gens qui ont à coeur de transmettre un message à leurs compatriotes.
Ce qu’en fait le gouvernement par la suite est assez secondaire, même si je suppose que beaucoup sont conscient·es du cynisme de certaines démarches. Cela dit, le gouvernement japonais n’est pas une entité monolithique et il existe probablement des gens de bonne volonté qui ont simplement envie de mettre ces contenus en avant sans pour autant être aux manettes de la législature.
Tu mets en valeur des techniciennes de cinéma comme Cho Sang-kyung, costumière et Ryu Seong-hie, décoratrice. Quel est le métier le plus accessible pour une femme selon les pays? Celui qui leur est le plus compliqué?
Là encore, je ne saurais dire avec certitude.
Beaucoup de postes à responsabilité sont en grande majorité occupés par des hommes. Certaines femmes parviennent à réaliser un ou deux films mais sont souvent contraintes d’interrompre leur carrière par manque de moyens financiers. C’est le cas en Corée du Sud où beaucoup de réalisatrices prometteuses s’arrêtent après un premier film très personnel, mais ne parviennent pas à transformer l’essai.
Évidemment, tout ceci varie en fonction des cultures et des pays : par exemple, les réalisatrices chinoises de premier plan sont moins nombreuses que leurs homologues japonaises. Pour autant, elles existent et il me semble important de mettre leur travail en avant.
De façon générale, en lisant les noms au générique des films que je regarde, j’ai l’impression que les métiers vraiment accessibles pour les femmes sont assez peu nombreux : actrice bien sûr, mais aussi scénariste, maquilleuse, coiffeuse ou costumière.
Ryu Seong-hie est un cas un peu à part comme elle a pour ainsi dire créé le métier de décoratrice de cinéma dans son pays. Elle se réjouit toutefois de l’augmentation du nombre de femmes sur les plateaux de tournage et a l’impression que les choses évoluent dans le bon sens.

Dans le podcast HKast, vous évoquez Cure de Kiyoshi Kurosawa et vous interrogez la position du film sur la psychiatrie. Est-ce que la psychophobie n’est pas finalement un point commun du cinéma d’horreur toutes nationalités confondues?
Je ne suis pas assez versée dans le cinéma d’horreur pour donner une réponse définitive sur la question mais c’est l’impression que j’en ai, en effet.
De manière générale, je trouve que Hollywood et les autres industries ont tendance à faire du sensationnalisme autour des troubles psychiques et de ce que l’on appelle “folie” par abus de langage psychophobe. En un sens, ces industries épousent le discours dominant porté par l’institution psychiatrique : c’est toujours un problème, un danger, quelque chose à corriger ou a minima une altérité qui met mal à l’aise.
Malheureusement, c’est quelque chose qui est très utilisé dans le cinéma d’horreur parce que la maladie mentale telle qu’on la conçoit dans notre imaginaire collectif est quelque chose qui fait peur par définition. C’est plus un problème social qu’un problème artistique, à mon sens.
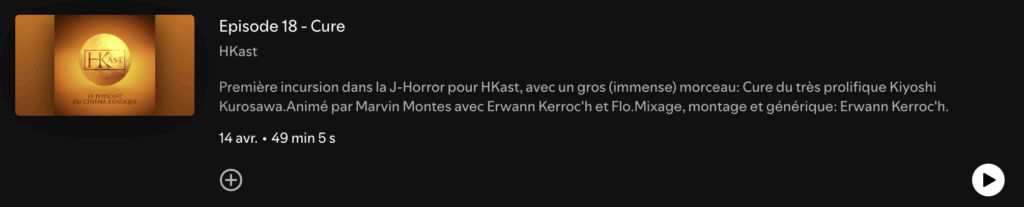
Concernant le cinéma horrifique, on a beaucoup de films Coréen et Japonais qui nous parviennent. Beaucoup moins de films Chinois, ou d’Inde. Comment l’expliques-tu?
Je ne connais pas la raison pour ce qui est de l’Inde, mais c’est très simple à expliquer pour la Chine : l’obscénité et les superstitions sont prohibées par la censure étatique. C’est pour ça qu’en dehors de quelques films hongkongais produits avant la rétrocession ou bien à l’étranger, la pornographie et le cinéma d’horreur n’existent pour ainsi dire pas. En revanche, les studios taïwanais produisent de nombreux films d’horreur en langue chinoise chaque année !
Certaines femmes parviennent à réaliser un ou deux films mais sont souvent contraintes d’interrompre leur carrière par manque de moyens financiers. C’est le cas en Corée du Sud où beaucoup de réalisatrices prometteuses s’arrêtent après un premier film très personnel, mais ne parviennent pas à transformer l’essai.
Le cinéma a une grande influence sur notre perception des représentations, et notamment des minorités. Quel est ton regard sur ce qu’on appelle la cancel culture?
…
Je pense que si certain·es ne voient en l’art qu’une énième manière de perpétuer des oppressions qui appartiennent au passé, on se passera d’elleux.
Il est toujours délicat de représenter les minorités et notamment la violence qu’elles subissent. Quel est ton regard sur ces violences représentées dans le cinéma asiatique? (ce que tu trouves pertinent ou non en termes de mise en scène, des films, etc..)
Je suis partagée sur la question. Tout d’abord, je pense qu’il faut garder en tête le contexte de production de chaque œuvre, et qu’il est important d’avoir un regard critique sur l’ensemble de la production mondiale.
Je considère qu’on peut expliquer certaines choses quand on sait qu’un film a été produit en studio en Chine continentale en 1993, sans pour autant les excuser. De la même manière, on peut déplorer certains éléments d’un film produit en France en 2023, sans pour autant rejeter l’œuvre en bloc.
L’Asie n’a pas vraiment de spécificité de ce point de vue là. Lutte des classes, féminisme, religion, identités queer : chaque culture entretient des liens différents et en constante évolution avec ces sujets. En ce moment, la pente est clairement à droite : le monde entier semble sombrer un peu plus dans l’obscurantisme chaque année. Pour autant, la Thaïlande vient de légaliser le mariage homosexuel et la Corée du Sud est parvenue à contrecarrer un coup d’état d’extrême droite.
Par conséquent, je ne pense pas que la violence soit représentée différemment en Asie. C’est vraiment un ressenti au cas par cas en fonction de chaque film et de la personne qui le regarde. On peut discuter de tout ça mais je pense qu’il vaut mieux éviter de généraliser à l’échelle d’un continent.
Comment définirais tu un film féministe? La définition diffère-t-elle quand on parle de cinéma asiatique ou européen selon toi?
Je pense que le terme est un peu galvaudé mais selon moi ce serait un film dont le propos serait ancré dans une lutte pour l’émancipation des femmes. Je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose qu’on puisse décréter en tant que cinéaste. C’est plutôt au public de s’approprier l’œuvre et de décider quels éléments au sein du film sont féministes.
Par exemple, Shao Yihui refuse de parler de féminisme quand elle évoque son film Her Story. C’est pourtant un film grand public qui bouscule le patriarcat chinois, là où le Barbie de Greta Gerwig faisait sensiblement la même chose aux États-Unis.

On dit souvent qu’une critique doit être « neutre » et ne surtout pas écrire à la 1ère personne. Qu’en penses-tu? Est-ce important de préciser d’où on parle?
Je pense que l’objectivité critique n’existe pas et que cette prétendue neutralité n’est guère plus qu’un écran de fumée pour un conservatisme bas du front. Évidemment que je parle à la première personne quand je donne mon avis sur un film ! Et même quand je ne dis pas “je”, il est sous-entendu que je donne mon opinion. Ce serait incroyablement prétentieux que de partir du postulat que l’on détient une sorte de vérité absolue et objective en tant que critique.
Au-delà de la posture morale et philosophique, je pense que c’est très prosaïquement utile de connaître la personne qui critique une oeuvre : si je sais ce qui déplaît à un·e journaliste ou à un·e créateur·ice de contenu, je peux avoir moi-même un regard critique sur ce que dit la personne.
Par exemple, je n’aime généralement pas les comédies musicales. C’est quelque chose que les gens qui me suivent depuis un moment savent probablement. Par conséquent, mon avis sur un tel film n’a pas le même intérêt que celui de quelqu’un qui est passionné·e par le genre. Pour autant, il n’est pas sans valeur : si je chante soudain les louanges d’une comédie musicale, c’est peut-être qu’elle propose quelque chose de différent qui pourrait plaire aux gens qui ont la même sensibilité que moi.
Si on cherche l’objectivité dans l’art, autant demander à une machine de rédiger la critique.
Peux tu citer 3 films asiatiques féministes selon toi?
C’est la question piège, ahah ! Je dirais : Saving Face d’Alice Wu dont les deux personnages principaux s’émancipent au fil du film. C’est une comédie romantique lesbienne mais ça parle aussi de parentalité, de la pression familiale et des oppressions qu’on perpétue malgré nous.
On peut aussi citer Joyland de Saim Sadiq qui dénonce les ravages de l’hétéropatriarcat et aborde de nombreux thèmes comme la masculinité, la transidentité, la liberté sexuelle et le sexisme.
Enfin, je citerais peut-être Les Anges portent du blanc de Vivian Qu, qui s’intéresse aux dynamiques de pouvoir entre hommes et femmes et brasse pas mal de thématiques autour du sexisme en Chine.
C’est horrible, j’ai envie d’en citer plein d’autres, ahahah !

Peux-tu évoquer des personnalités dans le cinéma asiatiques qui font bouger les lignes?
C’est difficile de savoir si quelqu’un a un impact direct sur la société.
Je pense que Leslie Cheung a eu une influence considérable à son époque, aussi bien au cinéma que sur scène. Lee Chang-dong est lui aussi à sa manière vecteur de progrès : il a produit les premiers films de plusieurs réalisatrices sud-coréennes comme Yoon Ga-eun et July Jung.
Naoko Yamada est aussi quelqu’un d’important dans le monde de l’animation, et ce serait difficile de ne pas citer Ann Hui dont la carrière force le respect.
Je crois que personne n’est irremplaçable mais que nous progressons petit à petit collectivement. Chaque fois qu’une femme, qu’une personne racisé·e, queer ou handi crée quelque chose, ça ajoute un peu de diversité à la culture mondiale. Par conséquent, je pense qu’on agit tous·tes pour faire bouger les lignes, que l’on fabrique les films, qu’on en soit l’objet ou qu’on en parle.
Où retrouver Flo: