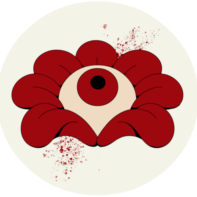La Verrue est le 2e court métrage de Sarah Lasry. Il raconte l’histoire d’une fillette nommée Salomé, qui se découvre un jour, une verrue sur le nez. Elle tente de composer avec ce détail gênant, et sa relation de plus en plus tendue avec ses parents.
La Verrue, sorti en 2021, a fait un petit tour des festivals spécialisés dans les films de genre, notamment le PIFFF où il a gagné plusieurs prix.
Je l’ai découvert à l’occasion de mon passage au festival Court Métrange, à Rennes où la réalisatrice Sarah Lasry était présente.
Les réalisatrices dans le cinéma de genre français étant toujours peu présentes, j’ai toujours plaisir à visibiliser leur travail.

1 – Critique: La Verrue
Un court métrage de genre français réalisé par une femme, qui fait référence à un élément emblématique de la sorcière: il ne m’en fallait pas plus pour avoir envie de découvrir La Verrue.
Par ailleurs, j’ai découvert sa réalisatrice dans le documentaire de Matis Catel, Laissez rentrer les monstres. J’avais particulièrement apprécié son regard sur ce qu’apportent les femmes dans le cinéma de genre.
La Verrue s’ouvre sur une petite fille est poursuivie par un homme dans une maison. Entre jeu et inquiétude, la scène fonctionne en reflet d’une séquence similaire dans Martyrs de Pascal Laugier, où une adolescente est poursuivie par son frère. Ces séquences traduisent une ambiguïté des sentiments et des personnages, qui traverse le début de l’adolescence de Salomé, l’héroïne de La Verrue.

Le cinéma de genre est connu pour traiter de l’adolescence (et notamment féminine), cette période faite de changements corporels mais aussi psychiques.
Dans La Verrue, on est constamment du point de vue Salomé, avec un angle assez peu traité au cinéma: la quête d’identité par le biais de non dits des adultes.
C’est pourtant une situation universelle, vécue par quasiment tout le monde; l’absence de capacité des adultes à communiquer avec leurs enfants, supposant ou espérant que les enfants ne comprennent pas.
Sarah Lasry, filme donc une maison des secrets, où l’expression « ce qui se cache derrière la porte » porte tout son sens. Elle reprend des références classiques de la sorcière (la verrue qui apparait sur le nez de Salomé, symbolisant à la fois un changement corporel, mais aussi un élément déstabilisant (autant pour Salomé que son père, à l’image de la situation amoureuse de ses parents), mais aussi la sorcière guérisseuse et référente en la personne du médecin, qui concocte une potion refroidissante pour traiter la verrue.

Que serait un film de sorcière sans une traditionnelle danse dans les bois? Ici elle fait davantage penser à une affirmation de soi, face à l’adulte, et qui plus est masculin, appuyée par une mise en scène qui filme cette danse comme une danse guerrière. Certainement la scène la plus puissante du court.
Cette verrue fait basculer le comportement de son père, qui est répulsé par celle-ci, à tel point qu’il ne voit plus sa fille qu’à travers ce défaut physique. Une situation que toute adolescente connait.
L’actrice Inès Mnafek-Amandio est impressionnante de maitrise, notamment de son corps et porte le film du début à la fin.
La Verrue oscille entre mise en scène réaliste ou naturaliste le jour, ponctuée par des incursions fantastiques la nuit, les moments où le mystère se joue.
La Verrue est un film prometteur pour la suite, qui manque parfois d’une vraie identité visuelle pour marquer, mais qui se démarque par un sujet passionnant et une direction d’acteur-rices maitrisée.
J’ai hâte de voir le 1er long de sa réalisatrice.
2 – Interview de Sarah Lasry, réalisatrice

Tu as grandi à côté de Chicago, étudié à Paris…Peux tu présenter ton parcours, qui tu es et comment tu es arrivée à être réalisatrice?
Oui j’ai grandi à Chicago et fait des études de théâtre au Royaume-Uni, puis travaillé comme journaliste culture à Paris. En 2013, j’ai écrit et réalisé mon premier court-métrage Les Voix volées et en 2017, lorsque j’ai été prise à l’Atelier scénario de la Fémis, j’ai décidé ensuite de me consacrer uniquement à l’écriture et la mise en scène.
La Verrue, ton 2e court métrage commence à parcourir les festivals et a même été récompensé au PIFFF. Comment tu ressens l’accueil en festival? Comment sont les retours?
C’est un film assez intime sur le sujet de la famille et j’ai été touchée lorsque certains spectateurs m’ont confié qu’ils se reconnaissaient dans cette histoire ou certains souvenirs d’enfance. Souvent les gens me parlent aussi de leurs histoires de verrues – à quels moments elles sont apparues, comment ils les ont soigné… C’est passionnant !
Le film peut être déstabilisant car j’ai choisi de laisser plusieurs pistes ouvertes, mais je trouve ça important que le spectateur puisse aussi former sa propre interprétation. J’ai été heureuse d’avoir autant de retours sur le jeu de mes comédiens, en particulier l’héroïne, Salomé, interprétée par Inès Mnafek-Amandio, pour qui c’était le premier film et qui avait 11 ans pendant le tournage.
« La verrue » utilise la verrue, un des éléments les plus clichés et ancien de la sorcière comme élément perturbateur. Le tout dans un contexte contemporain. Comment vois-tu la figure de la sorcière? Qu’est ce qu’elle signifie pour toi?
J’ai grandi avec la figure de la sorcière monstrueuse dans les contes et dans le cinéma, avec des films tels que Blanche Neige ou Le Magicien d’Oz… Enfant, la sorcière me terrifiait et me fascinait à la fois.
Avec le temps, j’ai réalisé que je me m’identifiais toujours plus à la sorcière qu’à la princesse dans les contes. J’aimais sa complexité. Elle était trouble, en marge de la société. La sorcière ne correspond pas à un idéal féminin fantasmé par l’homme et donc elle effraie. Car c’est avant tout une figure qui refuse de se conformer et c’est cette idée que j’ai voulu mettre en avant dans le film. J’ai voulu me réapproprier l’image de la sorcière « horrifique » pour la détourner en une figure puissante de la contre-culture féministe. Salomé découvre sa différence pendant le film et décide d’en faire une force, au lieu d’avoir honte.

La jeune actrice Inès Angelina Mnafek–Amandio est incroyable. C’est toujours plus compliqué de tourner avec des enfants. Comment s’est passé le casting et le tournage avec elle?
J’ai eu beaucoup de chance de rencontrer Inès, grâce à ma directrice de casting Kenza Barrah. Inès nous a d’abord envoyé une vidéo d’elle en plein confinement et on y sentait toute sa folie, son goût du jeu, son univers noir. Elle était profondément libre ! C’était une évidence pour nous. J’ai répété la scène de danse avec elle plus d’un mois avant le tournage, ça nous a permis d’apprendre à nous connaître, de créer un lien.
Pendant le tournage, elle a été d’un grand professionnalisme, tout comme India Lonis qui joue sa petite soeur. Elle était curieuse de tout, posait des questions aux techniciens, avait envie de refaire des prises. C’était une grande joie de tourner avec elles, toujours dans la concentration et le plaisir du jeu.
Peux tu expliquer d’où vient La Verrue? Comment t’est venue l’idée?
Petite, j’avais des verrues sur le nez et je faisais beaucoup de cauchemars de sorcières, sans jamais comprendre pourquoi… Plus tard j’ai compris que ces verrues étaient liées à des choses précises de mon enfance. Le film explore cela.
La scène d’intro avec le père qui poursuit sa fille, m’a beaucoup fait penser à celle de Martyrs de Pascal Laugier. Un mélange de peur, de jeu, d’excitation. C’est un peu ce que représente le cinéma de genre pour toi? Tu souhaitais représenter une certaine ambiguïté?
Ce que j’aime dans cette scène d’ouverture c’est que le père est à la fois incroyablement joueur avec ses filles, enfantin presque, et en même temps, on dirait presque un ogre. C’est évident que l’ambiguïté m’intéresse dans les personnages, la dualité. Je ne pense pas que ça se limite au cinéma de genre d’ailleurs !
Est-ce que La Verrue raconte l’histoire d’une petite fille qui commence à grandir et se rebelle contre son père dont elle ne comprend pas les attitudes?
Oui, c’est l’histoire d’une enfant qui sent un énorme non-dit au sein de sa famille et qui a besoin d’exprimer une rage face au silence de ses parents. Elle n’arrive pas à mettre des mots sur ce qui se passe dans sa maison, alors elle décide d’agir.
C’est assez rare de voir une forme de polyamour ou de « trouple » dans le cinéma de genre. Pourquoi ce choix ?
La forme du trouple est lié à mon histoire familiale, d’où mon choix d’explorer ce sujet, mais ce qui m’importait c’était de toujours rester du point de vue de l’enfant.
Le film de genre permet aux réalisatrices d’évoquer des questions politiques liées au corps, à la sexualité, la filiation, le racisme, la migration ou la maternité de façon radicale. Il y a un véritable public pour ces films et les producteurs l’ont compris.
Comment s’est passé le tournage? Combien de temps a-t il duré? Quelle a été la plus grosse difficulté?
Le tournage a duré 5 jours. On a tourné en octobre 2020. La plus grande difficulté était la course contre le temps en plein covid. La première journée de tournage était sans doute la plus difficile car la plus longue, on devait notamment filmer la danse dans la forêt en steadycam, des scènes de nuit aussi. Il pleuvait, on perdait la lumière du jour… Mais dans ces moments, il faut toujours garder son sang-froid. Heureusement, j’étais entourée d’une équipe très talentueuse, motivée et endurante !
On fait souvent le constat que les réalisatrices de genre peinent à passer au long métrage. Comment l’expliques tu ?
Au contraire ! J’ai l’impression de découvrir de nombreux films de genre réalisés par des femmes ces dernières années, que ce soit Julia Ducourneau, Ana Lily Amirpour, Rose Glass, Charlotte Colbert ou Mariama Diallo pour ne citer qu’elles. Le film de genre permet aux réalisatrices d’évoquer des questions politiques liées au corps, à la sexualité, la filiation, le racisme, la migration ou la maternité de façon radicale. Il y a un véritable public pour ces films et les producteurs l’ont compris.
Peux-tu nous parler de ton 1er long que tu prépares, La Sarramauca ?
Le film s’inspire d’une légende des Pyrénées et part d’un fait divers qui a eu lieu près de là où j’ai grandi, à la fin des années 1980.
Quels sont les longs métrages de genre qui t’ont marqué ces 5 dernières années?
J’ai une vision assez large de ce que peut être le film de genre. Mais dans le désordre, je dirais :
Memoria d’Apichatpong Weerasethakul, Un couteau dans le coeur de Yann Gonzalez, Burning de Lee Chang-Dong, Nope de Jordan Peele, Hérédité d’Ari Aster, Titane de Julia Ducourneau, High Life de Claire Denis, The Humans de Stephen Karam, The Strangers de Na Hong Jin… J’ai aussi adoré la mini-série Sharp Objects de Jean-Marc Vallée.

Quel est le sous genre que tu aimes le moins? Pourquoi?
Les plateformes ont été un peu une roue de secours pour le cinéma de genre, qui peine à se faire distribuer. Quel est ton regard sur cette éternelle guerre plateforme/cinéma?
Pour le court-métrage, les plateformes ont du sens car elles permettent aux films courts de continuer à exister, d’être vus par un plus large public. D’ailleurs La Verrue sera bientôt diffusé sur une plateforme spécialisée de genre.
Cependant, je défendrai toujours le cinéma face aux plateformes. Je refuse de croire que l’avenir reposera sur des algorithmes qui s’adressent au plus grand nombre. En particulier pour le cinéma de genre, je pense que nous avons besoin de voir ces films dans une salle de cinéma, dans le noir, avec d’autres spectateurs. Nous aimons ressentir des émotions fortes ensemble, c’est toute la force du cinéma !
J’étais vraiment pas fan de western, mais peut-être que Jordan Peele m’a enfin réconciliée au genre…
La Verrue de Sarah Lasry (2021), avec Inès Angelina Mnafek–Amandio, Sebastien Houbani, Judith Zins et Valentine Carette.
Production: Balade Sauvage Productions
Scénario: Sarah Lasry