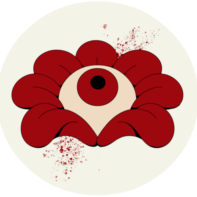Si Diaz n’est pas considéré comme un film de genre, je le range définitivement dans cette catégorie. La mise en scène utilise les codes du genre pour incarner le Mal à travers le système policier.
A Gênes en 2001, les affrontements entre la police les manifestant-es fait rage. Diverses personnes se réfugient dans l’école Diaz. Une nuit violente s’annonce.

Diaz de Daniele Vicari
Avec Claudio Santamaria, Jennifer Ulrich.
Scénario: Laura Paolucci et Daniele Vicari.
Photographie: Gherardo Gossi.
BAC ou pas BAC?

« Ne nettoyez pas ce sang ».
Réaliser Diaz (« un crime d’état ») est un acte militant. Refusé par les télés italiennes, le réalisateur a pu compter sur deux petites sociétés de production et Le Pacte.
Le film se divise en deux parties.
La première est consacrée à l’exposition des personnages, et la mise en place du contexte politique et social.
La tension grandissante qui finira par exploser, est symbolisée par une bouteille en verre qui se brise, lancée par un manifestant.
Diaz articule plutôt habilement les situations des différents protagonistes. Les différentes pièces du puzzle se rejoindront petit à petit, pour former le cœur de l’enjeu du film.
Des personnages qui n’étaient pas sensés se retrouver ensemble, sont contraints de se réunir dans un endroit symbolique: l’école. Un lieu public, qui stimule l’intellect. Ainsi, on a des journalistes, des activistes, des bénévoles, des enseignants…que des métiers qui sont reconnus comme d’utilité publique.
Diaz montre aussi le point de vue des antagonistes. De manière (trop) simple, il expose le pouvoir des dominants qui prennent des décisions sans être sur le terrain. Hors sol, ils n’ont pas conscience de la gravité des violences qui font monter petit à petit la haine. Ils sont particulièrement cyniques, sans nuances et c’est sans doute la grosse faiblesse du film. On sent que le réalisateur n’avait pas envie de comprendre ce qui construit ces personnages.
Dans une perspective quasi documentaire et didactique, Daniele Vicari nous présente des personnages sans ambiguïté. Il nous place du bon côté de la barrière.
Le Mal policier?

Dans un second temps, la deuxième partie est celle qui reprend les codes du cinéma de genre. De l’horreur. Les policiers sont représentés comme des croquemitaines qui pénètrent dans l’enceinte de l’école. La photographie devient sombre, oscillant entre le noir et le jaune qui accentuent le caractère dramatique de la séquence.
La police ne forme plus qu’une entité compacte, unique, qui est une métaphore de ce système étatique qui contient une violence systémique. Une sorte de monstre sans tête. La caméra se place au dessus de la police, et on ne distingue plus que la noirceur des casques. Ce monstre s’engouffre dans l’école et on sait que l’horreur va petit à petit gagner les occupants.
Les violences entre les deux camps quelques jours auparavant aboutiront à la haine des policiers. Ils n’ont plus supporté de se sentir dominés par des marginaux, ou des rebelles politiques. Ce besoin d’asseoir son pouvoir surpasse tout.
La tension est parfaitement orchestrée, et le décor s’y prête bien. Diaz est une sorte de labyrinthe sur plusieurs étages où les occcupant-es sont piégé-es comme des rats.
Comme un fléau ou une catastrophe naturelle qui submerge sans qu’on ne puisse agir, le bâtiment se fait envahir par la foule de policiers.
Mais pour ne pas basculer dans un schéma caricatural, il y a le personnage du policier qui tente de ramener à la raison son équipe. Qui permet une respiration. Sa solitude extrême et le fait qu’il peine à convaincre ses pairs, démontrent qu’il est très compliqué de faire évoluer le sytème de l’intérieur.
L’histoire que raconte Diaz est la plus grave atteinte aux droits de l’Homme depuis la seconde guerre mondiale par Amnesty International. C’est un film de genre qui bouscule. On sombre d’autant plus dans l’horreur parce qu’il fait écho à des évènements on ne peut plus actuels.