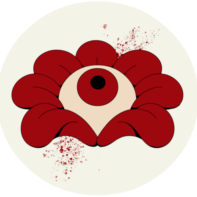Marie Casabonne est responsable éditoriale de la plateforme Univerciné, et est connue pour son travail au ciné club Parisien Panic!Cinéma. Elle écrit pour plusieurs media (Ecran Large, Capture Mag…) et vient de lancer une nouvelle émission Monster Squad.
On a parlé final girl, de sa passion du zombie, et du lien entre horreur et politique.

Peux-tu te présenter? (parcours, media dans lesquels tu interviens, etc..)
Je suis la présidente de Panic! Cinéma, un ciné-club parisien qui existe depuis 2011 et qui
programme des séances mensuelles et des festivals, notamment au Forum des images
depuis 2016.
Je suis chroniqueuse pour Capture Mag, j’écris pour Écran Large, et je suis
également autrice. J’ai co-écrit Slashers, attention ça va couper, paru chez Glénat fin 2021
et je termine en ce moment sur mon premier livre en solo qui sortira en 2024 chez Third
Editions. Enfin, je viens de rejoindre la plateforme Universciné en tant que responsable
éditoriale.
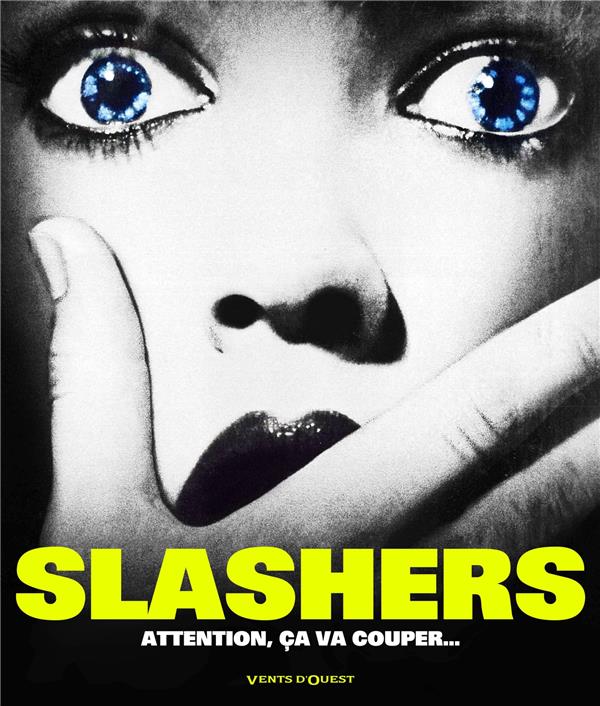
Tu es la cheffe de Panic! Cinema, un rdv incontournable du cinéma de genre sur
Paris. Peux-tu évoquer les origines du projet, les raisons de sa création? Comment
sélectionnez-vous les films?
Panic! Cinéma a été créé en 2011 par Yann Olejarz, et j’ai pour ma part rejoint l’équipe en 2013.
À l’époque, on organisait des séances hebdomadaires au Nouveau Latina (désormais
le Luminor) à Paris. On a ensuite fait une pause de quelques années avec quelques
événements ponctuels au Max Linder, au Grand Rex au Download Festival…
On a repris en 2016 au Forum des images pour 3 saisons, avec les Chromas, puis 4 saisons en solo avec
des séances mensuelles et un festival, La Colo, tous les étés.
On sélectionne les films qu’on aime : autant des classiques que des pépites méconnues. De
mon côté, j’essaie surtout d’avoir des invités intéressants, qui apportent une réelle valeur
ajoutée à la séance, pour parler du film et interagir avec le public.
Comment est née ta passion pour le cinéma de genre?
J’ai découvert les films d’horreur et de genre ado, avec Wes Craven, et la saga Freddy et
Scream (à l’époque, il n’y en avait qu’un seul !).
Je me souviens que dans mon collège, on
avait organisé un trafic de VHS d’horreur dans le dos de nos parents qui nous interdisaient
de regarder ce genre de films… C’était un double frisson à l’époque, on bravait d’une part
l’interdiction aux moins de 16 ans à laquelle le premier Scream était soumis à sa sortie, mais
aussi et surtout l’interdiction de nos parents !
Le cinéma de genre est considéré plutôt comme un cinéma de divertissement, alors
qu’il est très politique. Quels sont les films d’horreur dont la portée politique t’a le
plus marquée?
J’aime bien le film de zombies en tant que film politique, depuis Zombie de Romero jusqu’à
Dernier Train pour Busan, qui recrée une micro-société et ses divisions dans un train. J’aime
le fait que le zombie soit une sorte de miroir déformant de l’être humain, le reflet d’une
société, et qu’il cristallise les craintes et les névroses d’une époque.
Plus récemment, j’ai beaucoup aimé Sick of Myself, de Kristoffer Borgli, qui fait le pari de
mettre en scène deux protagonistes absolument détestables. Le personnage principal est
une jeune femme qui prend volontairement un médicament interdit pour subir ses effets
secondaires désastreux, qui font légèrement basculer le film dans le body horror. C’est un
film qui égratigne autant les personnes narcissiques en recherche constante d’attention, que
les marques qui se la jouent inclusives depuis quelques années, parce que c’est devenu un
argument commercial.
J’aime beaucoup le film de zombies et le post-apo. Tout d’abord parce que j’aime la créature
du zombie et ses différentes déclinaisons : zombies rapides, lents, en décomposition plus ou
moins avancée et avec parfois des signes distinctifs de qui était la personne ou ce qu’elle
faisait avant sa transformation. Le zombie, c’est un corps en décomposition, une menace
inarrêtable ou presque, c’est un être humain qui a perdu son âme, son humanité, mais il
permet aussi de révéler ce que deviennent les survivants, comment ils réagissent en
situation de survie. Le zombie permet de révéler comment l’humain, le survivant perd lui
aussi son humanité. Et le post-apo, pour les mêmes raisons, et pour ses paysages désolés,
comme dans La Route de John Hillcoat, sublime adaptation du roman éponyme de Cormac
McCarthy.

Le débat sur les remakes en masse et les sagas qui sont trop rebootées revient
souvent. Qu’en penses-tu?
Vaste sujet, mais qui n’est pas nouveau ! Historiquement, il y a déjà beaucoup de sagas
d’horreur dans les slashers des années 80. C’est une idée qui peut se défendre
scénaristiquement. On peut justifier le retour d’un personnage récurrent de méchant, d’un
boogeyman qui se relève toujours à la fin du film. C’était déjà le cas dès les années 30 dans
le cinéma d’horreur, avec les monstres Universal et ceux de la Hammer : Dracula,
Frankenstein, La Momie, etc… C’est ensuite évidemment un argument commercial, qui est
d’autant plus valable dans le cinéma d’horreur, qui est vite devenu un genre d’exploitation
car il ne coûte pas cher à produire et assure généralement un bon retour sur investissement.
Aujourd’hui, c’est évidemment plus compliqué. Il y a une énorme frilosité dans la production
de films et de séries, peu importe le genre. Très peu de films – en tout cas pour les
blockbusters et films à gros budget – ne sont pas issus de près ou de loin d’une saga ou
d’une franchise. Il n’y a plus de prise de risque et on préfère rebooter les films ou séries de
notre enfance pour s’assurer que notre génération va regarder, ne serait-ce que par
nostalgie.
Ces dernières années on évoque souvent que le cinéma de français connait un petit
rebondissement avec plus de films sortis. Qu’en penses-tu ? Que faudrait-il faire pour
que les films de genre français sortent avec plus de copies?
Je pense qu’il faut évidemment soutenir ces films. Ce n’est pas toujours évident de faire
venir le public en salle pour des films de genre faits par des réalisateurs ou réalisatrices peu
ou pas connus… Il faut donc susciter la curiosité du public et accompagner ces films,
organiser des projections événementielles, des rencontres avec l’équipe, des débats… C’est
ce qu’on essaye de faire chez Panic! Cinéma, et ce que font pas mal de cinémas et de
nombreux festivals.
Comment expliques-tu que le concept de saga se retrouve principalement dans le
cinéma de genre et moins dans d’autres genres?
Je pense que c’est assez logique. Le cinéma d’horreur est très vite devenu un cinéma
d’exploitation car ce sont des films qui représentent souvent un investissement minime pour
un gros profit. C’est ce qui s’est passé par exemple avec le slasher au début des années 80.
Halloween de Carpenter, c’est un budget de 325 000 dollars de budget, 20 jours de
tournage et des recettes de 70 millions de dollars dans le monde entier. Le premier Vendredi
13 quelques années plus tard a coûté 500 000 dollars et en a rapporté 77 millions au total,
entre la salle et l’exploitation vidéo. Donc logiquement, ça lance un genre, et il y a eu une
suite par an pour les grandes saga du slasher à cette époque…
Le concept en lui même de la final girl n’est pas féministe
Tu as co-écrit un livre sur le slasher où tu évoques le concept de la final girl. Peux-
tu rappeler rapidement la définition et quel rapport entretiens-tu avec ce concept?
Est-il féministe selon toi? La meilleure et la pire des final girl?
C’est un vaste sujet, qui mériterait un livre à lui tout seul ! Le personnage de la final girl
marque une étape dans le cinéma d’horreur et une évolution des personnages féminins, qui
ont longtemps été des victimes, avant de devenir les héroïnes féministes badass que l’on
connaît aujourd’hui. (Lisez, si vous comprenez l’anglais, Men, Women, and Chainsaws de
Carol Clover ; c’est elle la première à avoir théorisé le sujet !)
La final girl est un personnage féminin aux caractéristiques considérées comme masculines
: elle un prénom épicène (Laurie, Sidney…), elle est présentée comme un peu plus futée
que les autres, plus débrouillarde, moins superficielle… C’est celle qui va faire ses devoirs
ou du baby-sitting quand les autres filles sortent – et couchent – avec leur copain.
La final girl a une certaine complémentarité avec le tueur : elle serait une femme
‘masculinisée’ tandis que le boogeyman serait un homme ´fémininisé’, incomplet, emasculé.
Il tue en effet ses victimes à l’arme blanche, souvent un long couteau, avec toute la
symbolique phallique que ça implique… Il y a donc une sorte de fluidité de genre à l’œuvre
dans le slasher et dans le cinéma horrifique, qui lierait les deux personnages, jusque dans
l’affrontement final où la final girl retourne souvent son arme contre le tueur.

Je trouve l’explication psychanalytique du rôle de la final girl passionnante. Elle est un
personnage féminin maltraité par le film et par le boogeyman car c’est un véhicule
acceptable pour les spectateurs masculins. Ceux-ci sont censés pouvoir s’identifier à sa
souffrance car c’est une femme, donc il est acceptable qu’elle souffre et qu’elle crie… Alors
qu’il leur serait plus difficile de s’identifier à un personnage de final boy et de faire preuve
d’empathie envers une victime masculine. La preuve : le deuxième volet de la saga Freddy,
qui met en scène un final boy qui crie de manière très aiguë et qui est sauvé par son amie,
est l’un des plus détestés de la saga. Même s’il est devenu un avatar de la communauté
LGBTQIA+, pour son sous-texte homo-érotique, mais je m’égare…
Revenons à la final girl ! Une de mes final girls préférées est Jess Bradford, la proto final girl
dans Black Christmas, dès 1974. C’est un personnage progressiste avant l’heure. Elle est
sexuellement active, pense à avorter… C’est une final girl bien plus moderne que celles des
films qui vont suivre, car elle ne tombe pas encore dans l’écueil des tropes que le genre va
répéter sans cesse.
J’aime aussi évidemment beaucoup Laurie Strode, la première vraie final girl, interprétée par Jamie Lee Curtis dans le film fondateur du genre, Halloween de John Carpenter, en 1978. Enfin, dans Scream (1996), Sidney Prescott est la première final girl post-moderne et méta. C’est un personnage de final girl conscient d’en être une, et conscient des règles du genre, et donc à même de les déjouer pour reprendre le contrôle du film et de sa vie. Elle fait passer la final girl de victime passive qui subit à femme forte qui
agit. C’est aussi celle avec laquelle j’ai grandi et c’est aussi la première à être le personnage
récurrent dans toute la saga (sauf le dernier opus).
Je pense que le concept en lui-même n’est pas féministe, il est même plutôt sexiste si on
considère qu’initialement la final girl est sauvée car c’est un personnage féminin qui a des
caractéristiques considérées comme masculines, et qu’en gros c’est à son côté masculin
qu’elle doit sa force et son salut ! Néanmoins, je pense qu’il y a aujourd’hui une
réappropriation du genre horrifique par les femmes, qui enfin accèdent de plus en plus à des postes de scénaristes et de réalisatrices et qui mettent en scène des personnages féminins
qui sortent des clichés.
J’aime le fait que le zombie soit une sorte de miroir déformant de l’être humain
On constate qu’il y a plein de manières différentes de comprendre les messages
d’un film, notamment si on regarde d’un point de vue féministe. Qu’est ce que tu
considères comme féministe dans un film? As-tu des exemples de film où tu as pu
avoir des opinions divergentes sur la lecture féministe d’un film?
Ce qui me gêne un peu c’est qu’aujourd’hui dès qu’une femme réalise un film, d’autant plus
dans l’horreur, on l’analyse presque invariablement par le prisme du féminisme et de son
genre, alors qu’on ne se pose pas ce genre de questions quand c’est un réalisateur.
Ce que je considère féministe, c’est d’avoir des films portés enfin par des femmes, à des
postes-clés, à la production, au scénario, à la réalisation, pour raconter des histoires
féminines, développer des personnages féminins bien écrits, avec de vrais arcs et de vrais
enjeux.
Il y a des films qui n’ont pas été compris par le public, parce que très mal vendus. C’est le
cas de Jennifer’s Body de Karyn Kusama, écrit par Diablo Cody, avec Megan Fox dans le
rôle-titre. Un film porté par trois femmes, qui parle de l’amitié féminine et de ce que c’est que
d’être une adolescente, une lycéenne, avec un corps qui change et qui suscite le désir…
C’était un film a priori plutôt destiné à un public féminin, qui a été très mal vendu, en faisant
sa com sur le physique de Megan Fox, et qui a fait un bide, car le public-cible (féminin) s’en
est détourné et le mauvais public (masculin) est allé le voir et a forcément été déçu de ne
pas voir le film vendu par l’affiche qui capitalisait sur le physique de Megan Fox.
Récemment, je trouve que le cas de Barbie, de Greta Gerwig, est passionnant. Trop
féministe pour certains, pas assez radical pour d’autres. Je trouve que les débats autour
sont très révélateurs. On a maintenant un peu de recul sur le film, mais outre le fait qu’il
s’agit du premier film réalisé par une femme à dépasser le millard d’euros de recettes, quel
blockbuster attirant autant de public en salles a prononcé autant de fois le mot patriarcat ?
Certes son discours est trop didactique, le film est trop axé sur le personnage de Ken, le
discours du personnage d’America Ferrera a déjà été entendu… J’entends et je partage la
plupart des critiques. Mais je trouve enthousiasmant de voir un blockbuster calibré pour le
public féminin, et je me dis que si c’est vraiment le féminisme 101, il faut se rappeler qu’on a
toutes commencé quelque part et qu’il peut être une porte d’entrée pour plein de jeunes
filles.

On voit de plus en plus de réalisatrices de genre, on peut dire que les choses
évoluent et les femmes ont plus de place?
Je pense que c’est comme dans tous les milieux, au-delà du cinéma. De plus en plus de
femmes accèdent à des postes à responsabilités dans tous les milieux. Je pense aussi que
les palmes d’or de Julia Ducournau et Justine Triet sont un signe fort pour la représentation
des femmes dans le milieu du cinéma.
Quel type de personnage aimerais-tu voir ou voir plus souvent à l’écran?
Des personnages féminins réalistes qui racontent ou expérimentent des parcours féminins,
sans être essentialisés et cantonnés à des rôles de mère, ou de femmes badass avec
caractéristiques masculines. Mais de manière générale, je voudrais voir des personnages
masculins ou féminins bien écrits et réalistes ! Je pense qu’on en a tous et toutes un peu
marre de voir des personnages-fonctions et des clichés ambulants, surtout dans le genre et
l’horreur.
Ton dernier choc qui concerne un film d’horreur?
J’ai été assez hermétique (à mon grand regret) à pas mal de films d’horreur récents qui ont
pas mal fait parler d’eux (X, Pearl, Barbarian, Terrifier…).
Je dirais Hérédité, d’Ari Aster, parce que je ne savais pas du tout ce que j’allais voir, je ne savais pas où le film m’emmenait. Ça a donc été une réelle surprise, et surtout un gros malaise. Sinon, j’ai vu
Vincent doit mourir en festival, qui sort en novembre. C’est un super premier film, porté par
Karim Leklou et Vimala Pons, une sorte de comédie romantique post-apocalyptique. J’ai
hâte de voir la suite de la carrière de Stéphan Castang.
Un film d’horreur méconnu qui mériterait d’être plus vu?
J’ai adoré The Night House de David Bruckner, avec Rebecca Hall, sorti en 2021. C’est
l’histoire d’une jeune femme qui se retrouve seule après le suicide inexpliqué de son
compagnon. Ce n’est pas tant un film d’horreur qu’un thriller fantastique et psychologique,
avec de très bonnes idées de mise en scène, notamment autour de la maison du couple et
des notions de présence et d’absence. Et il faut évidemment saluer la performance de
Rebecca Hall, qui porte le film du début à la fin, magistrale, comme toujours.
J’aime aussi beaucoup Behind The Mask: The Rise of Leslie Vernon de Scott Glosserman, 2006, un
mockumentary assez malin sur un tueur qui s’inspire de Michael Myers, Jason Voorhees et
consorts, dans un monde où ils sont réels. Il est suivi par une équipe de journalistes à qui il
explique sa façon de travailler, comme dans C’est arrivé près de chez vous. Et aussi Ginger
Snaps, mais tu as écrit tout un dossier sur le film et ses deux suites !
Un projet que tu aimerais réaliser?
Comme je le disais en préambule, je suis en train de terminer l’écriture de mon premier livre
en solo, après un an et demi de travail, et j’ai hâte de passer aux étapes suivantes jusqu’à la
publication. Je viens de lancer nouvelle émission sur le cinéma d’horreur chez
Capture Mag. Ça s’appelle Monster Squad et le premier épisode est en ligne depuis le 31st
octobre pour Halloween !